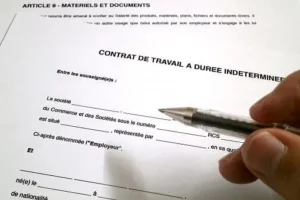Les congés payés font régulièrement parler d’eux dans les médias, notamment lorsqu’il s’agit, pour les salariés, d’optimiser leur durée en les posant habilement. Or, la législation relative aux congés payés, à la fois complexe et détaillée, d’ordre public, oblige l’employeur, par diverses obligations successives, à organiser concrètement leur prise. Celle-ci ne peut faire l’objet d’aménagements par accord entre l’employeur et le salarié.
La prise effective des congés payés est essentielle et participe au respect par l’employeur de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés. Il est crucial de suivre scrupuleusement ces règles : à défaut, l’employeur pourrait voir sa responsabilité engagée de plusieurs manières.
👉 Dans cet article, découvrez les principales règles encadrant les congés payés, les obligations à anticiper dès 2025, ainsi que leurs conséquences concrètes pour les employeurs, notamment en matière de santé, de sécurité et de responsabilité.
1. Prise des congés payés : que doit faire l’employeur?
La période de prise des congés payés est prévue par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixé1. En l’absence d’accord collectif, il revient à l’employeur de la déterminer, après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE2). À minima, elle s’étend impérativement du 1er mai au 31 octobre de chaque année3.
La période de prise des congés payés doit être portée à la connaissance des salariés par l’employeur au moins deux mois avant son ouverture.
Exemple: Si la période retenue par l’employeur va du 1er mai N au 31 mai N+1, l’information des salariés sur la période de prise doit leur être transmise au plus tard fin février N.
2. Congés principal et fractionnement : les règles à connaître
Au cours de la période fixée, le salarié doit bénéficier de son congé principal, qui, sauf dérogation individuelle liée à des situations particulières, ne peut excéder 24 jours ouvrables4.
Lorsque ces 24 jours ouvrables ne sont pas pris de manière consécutive, on parle de fractionnement du congé principal. Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire5.
Le fractionnement, à l’initiative de l’employeur, implique l’accord du salarié et la réciproque est également vraie.
Sauf renonciation individuelle du salarié, ou renonciation prévue par un accord collectif, le fractionnement du congé principal peut entraîner l’octroi de jours supplémentaires de congés lorsque, indépendamment de la période prise et fixée, le reliquat du congé principal au 31 octobre est au moins égal à 3 jours ouvrables.
3. Dates de congés payés : l’employeur omnipotent?
En l’absence d’accord d’entreprise, d’établissement ou de branche fixant l’ordre des départs pendant la période de prise des congés, il revient à l’employeur de le définir, après avis du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur doit prendre en compte :
• la situation de famille des bénéficiaires ;
• la durée de service des salariés ;
• et, le cas échéant, leur situation de cumul d’emplois.
L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié 1 mois avant son départ. Il convient de rappeler que les conjoints et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant au sein de la même entreprise ont droit à un congé simultané.
La fixation unilatérale des dates de congés payés par l’employeur, telle qu’elle semble prévue par le Code du travail, est souvent éloignée de la réalité. En effet, les salariés expriment généralement leurs souhaits, soit via un outil dédié, un formulaire papier ou à l’oral. Il est essentiel de rappeler que ces demandes ne constituent que des souhaits et ne déterminent en aucun cas les dates effectives des congés.
La fixation des dates de congés payés reste de la compétence exclusive de l’employeur. Il est recommandé, après communication de la période de prise des congés, que l’employeur sollicite les salariés pour qu’ils soumettent leurs demandes. Cela lui permet de gérer efficacement les conflits éventuels en se basant sur les critères d’ordre et de communiquer officiellement aux salariés les dates retenues.
4. Et si la fermeture était la solution?
Tout dépend de l’activité économique de la structure et de la volonté de l’employeur. La fermeture reste une option à explorer et permet d’éviter l’arbitrage de demandes de congés payés de salariés voulant partir aux mêmes dates.
L’accord du salarié n’est pas requis en cas de fermeture, et ce, même en cas de fractionnement du congé principal.
Si la fermeture excède la durée du congé principal (24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés), l’employeur doit alors verser aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité différente qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés, mais qui ne doit pas être confondue avec cette dernière⁶.
Une problématique peut néanmoins se poser concernant la gestion des salariés nouvellement embauchés, qui ne disposent pas encore suffisamment de droits à congés pour couvrir toute la période de fermeture.
Si la pratique de la fermeture annuelle est bien établie dans l’entreprise, cette situation doit être abordée dès l’embauche.
5. En pratique, comment ça fonctionne la pose de congés payés ?
En pratique, la pose des congés payés suit un cadre légal strict, tout en laissant une certaine latitude organisationnelle à l’entreprise. Voici les grandes étapes et règles à respecter :
1. Période de prise des congés
La période durant laquelle les congés peuvent être posés est fixée par :
- un accord d’entreprise, d’établissement ou de branche ;
- à défaut, par l’employeur, après consultation du CSE (comité social et économique).
Cette période s’étend obligatoirement du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les salariés doivent être informés au moins 2 mois à l’avance de cette période.
2. Demande de congés
Les salariés formulent leurs demandes de congés, généralement via :
- un outil RH ou un formulaire,
- ou de manière plus informelle (oralement ou par mail dans les petites structures).
Il s’agit de souhaits, non d’un droit automatique. L’employeur reste seul décisionnaire sur les dates effectives, en fonction de l’ordre des départs et des impératifs de service.
3. Ordre des départs
En l’absence d’accord collectif, l’ordre est établi en tenant compte de :
- la situation familiale (conjoint ou partenaire dans la même entreprise),
- l’ancienneté,
- les situations de cumul d’emplois,
- la continuité de l’activité.
Il doit être communiqué au moins un mois avant le départ en congé.
4. Congé principal et fractionnement
Le congé principal (jusqu’à 24 jours ouvrables) doit être pris pendant la période légale. Il peut être fractionné si les 24 jours ne sont pas pris d’un bloc. Ce fractionnement peut donner lieu à des jours supplémentaires, sauf renonciation expresse du salarié.
5. Fermeture annuelle
L’entreprise peut décider d’une fermeture annuelle, imposant des congés à tous les salariés. Dans ce cas :
- l’accord du salarié n’est pas requis,
- si la fermeture dépasse les droits à congés, une indemnité compensatrice doit être versée pour les jours excédentaires.
FAQ – Congés payés : ce que vous devez savoir
1. Quelles sont les règles à connaitre pour les congés payés ?
En France, tout salarié a droit à des congés payés à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (équivalant à 5 semaines) pour une année complète.
Dans certaines entreprises, les congés sont exprimés en jours ouvrés : dans ce cas, le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an.
La période de prise des congés est fixée par accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, ou à défaut par l’employeur après consultation du CSE. Elle doit obligatoirement inclure la période du 1er mai au 31 octobre.
L’employeur est tenu de veiller à ce que les congés soient effectivement pris, dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié.
2. Est-ce que je peux prendre mes congés quand je veux ?
Non, pas librement. Le salarié peut proposer ses dates de congés, mais celles-ci doivent être validées par l’employeur, qui organise les départs en tenant compte :
- de l’activité de l’entreprise,
- des situations familiales (par exemple, les conjoints travaillant dans la même entreprise peuvent bénéficier de congés simultanés),
- de l’ancienneté,
- des situations particulières (comme le cumul d’emplois).
L’ordre des départs doit être communiqué au moins un mois à l’avance. L’employeur peut refuser ou imposer des dates, notamment en cas de fermeture annuelle.
3. Quelles sont les règles pour l’acquisition des congés payés ?
Les congés payés s’acquièrent à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an. Certaines conventions ou accords les expriment en jours ouvrés (soit 2,08 jours ouvrés par mois, pour un total de 25 jours ouvrés par an).
Depuis les évolutions récentes, l’acquisition se fait en temps réel, y compris pendant certaines absences telles que :
- le congé maternité ou paternité,
- les arrêts pour accident du travail (sous conditions),
- le congé parental d’éducation (sous réserve d’éventuelles limitations).
La période de référence est généralement fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sauf accord collectif spécifique.
4. C’est quoi la nouvelle loi pour les congés payés ?
La jurisprudence de la Cour de cassation de septembre 2023, bientôt transposée dans la loi, a renforcé les droits des salariés en matière de congés payés :
- Les arrêts maladie, même non professionnels, permettent désormais l’acquisition de congés payés dans certains cas.
- Les congés non pris pour cause de maladie peuvent être reportés sur 15 mois, à condition que le salarié ait été informé de ses droits.
- Les employeurs doivent adapter leur gestion pour éviter les contentieux et les rappels de congés sur plusieurs années.
Ces changements visent à se conformer au droit européen, tout en apportant un cadre plus sécurisé pour les entreprises.